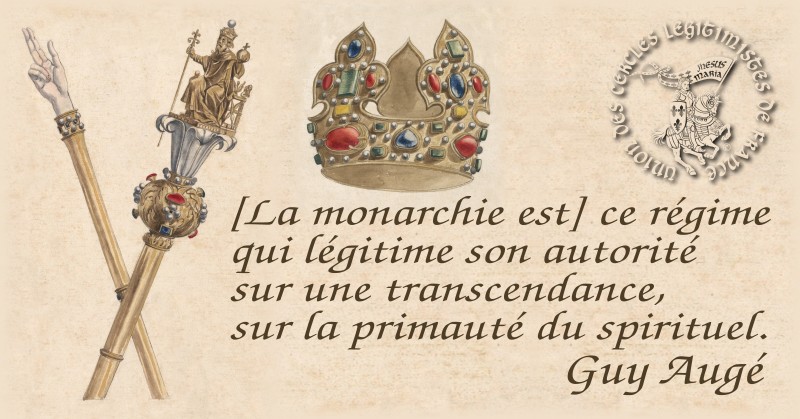Quelle est la situation de la monarchie dans la philosophie politique ? Quel est le modèle historique de la monarchie française, et enfin, quel est son héritage ? Telles sont les questions abordées par Guy Augé dans cette remarquable synthèse.
Table des matières
Introduction de Vive le Roy
Texte tiré la revue La Science Historique, printemps-été 1992, nouvelle série, n° 26, p. 49-67.
AVERTISSEMENT : Les titres ont été ajoutés par la rédaction de VLR pour faciliter la lecture en ligne.
Une monarchie aujourd’hui mal connue
Un régime déprécié par la modernité
Aux yeux de beaucoup, les monarchies font aujourd’hui figure de régimes d’un autre âge. Celles qui existent encore (en Europe, une bonne dizaine) sont, tout au plus tolérées, à condition de se faire discrètes et de se fondre dans le processus général de légitimité démocratique, alors qu’étymologiquement monarchie et démocratie devraient s’exclure.
Mais l’inactualité de la monarchie est-elle une objection sérieuse à l’intérêt qu’elle peut susciter ? Cela impliquerait qu’il y eût, en politique, un sens linéaire de l’Histoire, une sorte de progrès indéfini, tel qu’on l’imaginait au XVIIIe siècle, tel que nous en sommes passablement revenus : est-ce un progrès que les camps d’extermination, le goulag, les bombes atomiques, les lavages de cerveaux et les génocides, toutes marques de modernité ? Nazisme, stalinisme, maoïsme (pour ne faire un sort qu’aux plus grands) surclassent-ils en amélioration éthique et civique les monarchies d’antan ? Est-ce dans la France de Louis XIV qu’on exhumait des charniers ?
Une institution supérieure, héritière d’une sagesse séculaire
Si, à l’inverse, la monarchie pouvait apparaître comme une institution supérieure, héritière d’une sagesse séculaire, comme l’ont cru beaucoup de philosophes politiques (certainement une majorité d’entre eux), le fait qu’elle puisse sembler présentement inactuelle témoignerait, au fond, contre notre temps, incapable de mériter le moins mauvais des régimes. Les grandes idées ne sont pas d’aujourd’hui ou d’hier ; il ne faut pas tant vouloir marcher « avec son siècle » qu’essayer, humblement, d’approcher la vérité, difficile à éclairer en politique plus qu’ailleurs.
Il n’est sans doute pas indifférent que les hommes de tradition essayent de porter témoignage sur la monarchie, dont on peut dire qu’elle est beaucoup plus qu’une forme de gouvernement. Garder ce « dépôt sacré des vieux âges », c’est un peu ce qu’avait voulu faire, il y a un siècle, le comte de Chambord, le petit-fils de Charles X. Lui qui répétait : « Ma personne n’est rien, mon principe est tout », avait conscience de représenter une institution, peut-être provisoirement passée de mode, mais qui représentait encore une potentialité pour l’avenir. Ne soyons pas les myopes de notre époque : l’objection d’anachronisme relève de la mode, non de la philosophie politique.
En outre, l’idée monarchique passe infiniment au-dessus de la médiocrité de quelques monarques qui l’incarnent présentement, et qui paraissent, en général, fort inférieur au principe qu’ils représentent.
Un régime fondé sur la transcendance
Qu’est-ce que la monarchie, en première approximation ? C’est, substantiellement, ce régime qui légitime son autorité sur une transcendance, sur la primauté du spirituel.
La monarchie, pour peu qu’elle ait un sens profond, repose sur une mystique d’origine surhumaine. En France, par exemple, elle fait partie d’un héritage culturel millénaire. Car, bien sûr, la France n’est pas née en 1789 : elle remonte au moins à 987, date d’émergence de sa dynastie nationale ; peut-être encore au-delà, à 751, date de l’inauguration du sacre en Gaule, sous Pépin le Bref, avec l’avènement des Carolingiens ; quant à la monarchie, probablement devrait-on reculer plus encore ses racines, jusque vers 496, au baptistère de Reims, lorsque Clovis se fit catholique.
Une autre notion de la légitimité
C’est une fort longue histoire que celle de la monarchie française, dont il demeure, disait Jaurès, un « charme séculaire ». Et les Français, malgré qu’ils en aient, restent sensibles à ce charme. Dès qu’un prince quelconque, de par le vaste monde, se marie, la télévision fait frémir Margot dans les campagnes et les magazines multiplient leurs tirages en couleurs.
Mais la monarchie n’est pas seulement une sensibilité, cette sorte de bibelot décoratif que l’on voudrait nous faire accroire ; elle est moins encore, malgré ce qu’insinuent les royalistes contemporains1, et même certain prétendant abusif, le garant d’une bonne démocratie2 ; elle représente, si elle a quelque relief, une autre notion de la légitimité.
Essayons de situer la monarchie parmi les formes politiques inventées en Occident avant de singulariser un peu plus le modèle historique français.
Place de la monarchie dans l’histoire de la philosophie politique
Étymologie du mot monarchie
Transitant par le bas-latin, le mot de monarchie a une étymologie grecque fort claire : c’est le commandement d’un seul (monos, arkhein).
« Monarque » reste cependant quelque peu ambigu : de nos jours, on appellera parfois « monarques » (pas toujours par dérision) un chef d’État républicain : De Gaulle, Mitterrand eurent droit à ce qualificatif. Peut-être vaudrait-il mieux distinguer, à cet égard, entre monarchie et monocratie, pour réserver à la seule monarchie le gouvernement d’un seul héréditaire. Mais faudrait-il nier que la Papauté fût une monarchie ? Cela serait assez choquant.
Autre remarque préalable, le terme de monarchie, à la différence, par exemple, de celui d’aristocratie (qui est le gouvernement des meilleurs, aristoï), est purement descriptif : la notion est neutre, en quelque sorte. Elle ne témoigne, ontologiquement, ni d’un bon, ni d’un mauvais régime : elle vise tous les types de régimes caractérisés par le gouvernement d’un seul.
Pourtant, la monarchie a acquis, précisément à travers la réflexion des philosophes, une connotation plutôt favorable, du fait de l’emploi d’autres termes pour désigner les mauvais gouvernements d’un seul.
– Ainsi, la tyrannie, rapidement définie3 comme le gouvernement d’un seul régnant en marge des lois, dans son propre intérêt, de manière égoïste, illégitime ou usurpatrice ;
– ainsi le despotisme, qui n’est d’ailleurs pas uniquement le mauvais gouvernement d’un seul, car il peut tout aussi bien apparaître un despotisme démocratique, ou une « tyrannie de la majorité » comme dit Tocqueville4 ;
– il y a aussi la dictature, gouvernement d’un seul en mauvaise part de nos jours, mais qui n’avait, à Rome, rien de péjoratif : quelque chose anticipant sur l’actuel article 16 de notre Constitution, la dictature réputée de salut public.
Quoiqu’il en soit, ces termes, axiologiquement négatifs, se sont distingués de « monarchie », si bien que, d’ordinaire, les auteurs, parlant de ce dernier régime, y voient la bonne forme du gouvernement d’un seul.
Justifications de la monarchie
La monarchie est un régime que nous trouvons à l’aube même de l’humanité. Assurément, la forme la plus répandue à travers l’histoire. M. Roland Mousnier, dans un ouvrage consacré à ce sujet5, la fait remonter au paléolithique supérieur, soit quelque dix mille ans avant notre ère. Une foule de peuples a connu la monarchie. Or, les hommes ne deviennent pas absurdes au fur et à mesure qu’on remonte le temps ; il y a donc à parier qu’ils avaient des arguments en faveur de ce régime, défendu par de très nombreux auteurs.
Tous les partisans de la monarchie ont, au moins depuis Homère6, souligné l’avantage de l’unité de commandement.
Certains modernes ont présenté une défense globale de la monarchie. Ainsi Thomas Hobbes, vers le milieu du XVIIe siècle, a donné dans son célèbre Léviathan une classification des gouvernements où il n’oppose pas monarchie et tyrannie : c’est toujours du même gouvernement d’un seul qu’il s’agit, expose-t-il7, qu’on appelle tyrannique lorsqu’on ne l’aime pas. Ce gouvernement d’un seul est supérieur pour plusieurs raisons : d’abord, et cet argument aura du poids dans la suite des temps, on le retrouvera jusque chez Maurras après qu’il a passé par Bossuet, — il y a identité entre l’intérêt privé du monarque et l’intérêt général de l’État ; le monarque, en effet doit s’efforcer de bien gouverner s’il veut rester paisiblement sur son trône et avoir un règne confortable. En outre, insinue Hobbes, un roi est plus facile à conseiller et moins corruptible qu’une assemblée. Le gouvernement monarchique est le meilleur dans l’absolu.
Écrivant à la même époque que son illustre compatriote, et à peu près pour la même cause, Sir Robert Filmer fournit une autre apologie du gouvernement d’un seul. On la connaît principalement à travers la charge caricaturale qu’en fit Locke dans ses Traités du gouvernement civil. Filmer développait le thème du gouvernement patriarcal. La monarchie est le meilleur des régimes parce qu’elle a été voulue de Dieu instituant Adam comme chef de la lignée humaine.
Les monarques sont les descendants d’Adam. Filmer associe les idées de roi, de père et de patriarche. Les royaumes lui paraissent constitués non d’individus mais de familles, de tribus, à la tête desquelles doivent se retrouver de légitimes descendants d’Adam. Filiation délicate à établir, convenait Filmer, qui, pratiquement suggérait de respecter les monarques en place, en les présumant héritiers d’Adam.
Une autre justification de la monarchie dans l’absolu peut se rencontrer, au début du XIXe siècle, chez Louis de Bonald. La monarchie, estime cet auteur, s’impose parce qu’elle est l’expression de la sociabilité humaine, et que le roi est l’incarnation d’un groupe : en disant « Nous », il récapitule, en quelque sorte, son peuple.
Platon : le bon gouvernement respecte la loi léguée
La tradition classique, cependant, préfère distinguer entre bon et mauvais gouvernement d’un seul. La « république » idéale de Platon, par exemple, est aristocratico-monarchique, étant gouvernée par des philosophes-rois qui peuvent être un ou plusieurs. Le livre VIII de sa Politeia nous explique comment la constitution parfaite dégénère, se dégradant d’abord en timocratie lorsque ce sont les brutes guerrières qui s’emparent du pouvoir, puis en oligarchie quand l’emporte l’appât de l’or, puis en démocratie dont le principal défaut est de mener à la tyrannie, laquelle est le pire des régimes. La tyrannie est ici8, pour Platon, le gouvernement d’un seul en mauvaise part.
Platon qui a passé sa vie à chercher le meilleur régime, distingue, dans le Politique, parmi les formes de gouvernement, celles qui sont « réglées » et celles qui ne le sont pas : il réintroduit l’idée de loi, qu’il avait bannie de sa République antérieure : à l’instar du médecin quittant son patient en lui laissant des ordonnances, le philosophe-roi législateur donnera des lois à ses successeurs. Les gouvernements qui respectent les lois sont réglés ; la royauté est l’un d’eux. Ceux qui refusent ces lois sont déréglés, telle la tyrannie ordinaire.
Dans son dialogue de la vieillesse sur Les Lois, Platon en arrive à une autre conception. Deux régimes primordiaux existent, expose-t-il9 : la monarchie et la démocratie ; ces deux régimes fonctionnent mal parce qu’ils sont portés aux extrêmes. Ainsi, la monarchie (dont le prototype est en Perse) est fort avantageuse quand elle est régie par un Cyrus ; elle devient une catastrophe avec les fils de Cyrus, élevés par les femmes dans les mollesses du harem et dans la corruption. De même, la démocratie athénienne peut être, à un certain moment, un régime de juste mesure ; mais elle dégénère un peu à l’instar des lois musicales. Naguère, l’on écoutait religieusement la musique, dont les règles étaient édictées par ceux qui savaient ; peu à peu, malheureusement, l’on s’est abandonné à l’opinion, aux compositions musicales et ce sont les démagogues qui ont régné. La démocratisation de la musique a entraîné celle des mœurs en général et de la politique en particulier.
Monarchie et démocratie apparaissent ainsi comme deux régimes excessifs qu’il faudrait compenser par un gouvernement mixte. Voilà introduite une idée qu’Aristote allait s’empresser de développer.
Aristote : le bon gouvernement se soucie du bien commun
Le Stagirite au livre III de sa Politique, classe les régimes selon un critère quantitatif et qualitatif. Le nombre définit trois régimes qui ont perduré en science politique ; mais, selon que ces trois régimes visent le bien commun ou l’oublient, ils se dédoublent. Ainsi retrouve-t-on deux sortes de gouvernement d’un seul : la monarchie ou royauté, qui est bonne, et la tyrannie, qui est mauvaise.
Au vrai, Aristote n’est pas exactement favorable à la monarchie royale10 ; dans l’absolu, elle est sans doute le meilleur gouvernement, et si l’ont trouve un homme excellent, une famille excellente, on leur confiera le pouvoir ; pourtant, la nature ne suscite pas de ruches humaines, et les bons rois sont rares : la prudence suggère donc de mêler en une constitution mixte ces deux régimes mauvais (les plus répandus en Grèce, du temps d’Aristote) que sont l’oligarchie et la démocratie.
En vérité, les Grecs « classiques » n’ont jamais bien conçu la monarchie, qui s’adaptait mal aux cadres de leurs Cités libres. Il n’y eut de monarchie, en Grèce, à quelques exceptions près (Sparte ? et encore…) qu’aux temps homériques, protocitadins, ou bien à l’époque hellénistique, une fois brisé le vieux cadre de la polis au profit des empires. Encore cette monarchie païenne grecque fut-elle, presque toujours, un régime de gouvernement personnel, à l’hérédité mal dégagée, à la succession douteuse. Le « courant monarchique » du IVe siècle a exalté l’homme exceptionnel l’homme providentiel plutôt que l’institution monarchique. La réflexion grecque ancienne sur la monarchie est restée incomplète, et ne pouvait que le rester.
Saint Isidore de Séville : la royauté est un fardeau mais aussi un ministère religieux
Lorsqu’intervient la révélation chrétienne, la notion de royauté prend une dimension nouvelle. Nul, probablement, n’a mieux marqué cette métamorphose que saint Isidore de Séville, cet évêque hispano-romain qui fut une des gloires de l’Espagne wisigothique au tournant des VIe – VIIe siècles. Les historiens ont cru apercevoir, tour à tour, en lui, « l’instituteur de l’Occident », ou carrément « un imbécile » : mais Dante n’avait pas hésité à le placer au quatrième ciel de son Paradis…
Sur le plan doctrinal, Isidore a réhabilité les royautés barbares de l’Occident en les lavant de leur péché d’origine, de leur statut d’infériorité face à l’Empire. En principe, seul l’Empire était dépositaire des promesses de durée ; seul il semblait exprimer les desseins politiques de Dieu sur les hommes. Face à lui, les monarchies barbares n’étaient que des accidents de l’Histoire, des contrefaçons. César seul était légitime.
Avec Isidore, la royauté est restaurée dans sa dignité ; elle devient un service du peuple chrétien, cependant que l’Église tout entière se substitue à l’Empire comme principe d’universalité.
Cette substitution amène une vision nouvelle du monde. L’idée d’Empire n’admettait pas de puissances temporelles rivales. Au contraire, l’Église s’accommode du pluralisme politique. Mystiquement, elle trouve son unité dans le Royaume du Christ ; humainement, elle se compose d’une multitude de cellules : à chaque peuple, son évêque et son roi.
En inventant le concept de royauté chrétienne, au lieu de l’Empire devenu oriental et lointain, Isidore conférait aux royautés barbares de l’Occident une légitimité propre et neuve. La royauté humaine, pour lui, se rattache à la Royauté du Christ. Isidore a développé ce thème pour des raisons moins politiques que théologiques : pourfendant les Juifs et les ariens, qui avaient en commun de mettre en question la Trinité divine, de rabaisser le Fils, il a conçu, avant tout, une christologie. Or, le nom du Christ exprime sa royauté. Il est l’« oint » des prophéties, il descend de David, il n’abolit pas la royauté d’Israël mais l’achève « pour les siècles des siècles ». Il y a, désormais, un Royaume mystique des Juifs qui est l’Église.
La Royauté du Christ n’exprime cependant pas la puissance et la domination, car le Christ est l’Époux de l’Église, il est la tendresse. Sa devise est prodesse, non necere. Ce devra être aussi la devise de la royauté chrétienne. Cette royauté que, d’après la tradition biblique, le peuple juif avait demandée « pour être semblable aux autres nations », fut, en définitive. Sa marque distinctive dans l’ordre politique, et comme le symbole de son élection divine dans l’ordre religieux. Puis, avec la venue du Christ, ce qui était le privilège d’une nation devint la grâce du monde entier.
Or, s’il y a coïncidence entre royauté biblique et royauté chrétienne, c’est par imitation de Jésus-Christ : la Royauté du Christ a servi de relais.
Cette royauté chrétienne, pour Isidore et les augustinistes, ne se conçoit plus que dans l’Église et par rapport à elle. L’entrée du Prince dans l’Église amène une conversion du pouvoir même. Non seulement elle met un terme à la guerre entre l’Église et la Cité terrestre mais elle change la nature du pouvoir royal. Le pouvoir n’est plus simplement la sanction du péché, comme l’aurait encore dit saint Ambroise deux siècles et demi plus tôt : il est aussi son remède.
La royauté est un fardeau, une servitude glorieuse, qui requiert une exceptionnelle force d’âme : rex a recte agendo, explique Isidore dans une formule de ses Étymologies cent fois glosée ; est roi celui qui agit avec rectitude ; le roi qui manque à son devoir trahit son nom et son ministère.
Le Roi chrétien médiéval va donc revêtir une allure religieuse qu’il n’avait guère dans la pensée antique. En France, il est Gratia Dei rex depuis les siècles carolingiens, et Rex christianissimus ; on a pu parler, sous Louis VII, d’une « episcopalisation de la fonction royale » (Marcel Pacaut).
Saint-Thomas d’Aquin, dans le De regno, brosse une apologie de la royauté, celle qu’il voit fonctionner avec saint Louis. Au travers des rudes épreuves successives que sont la guerre de Cent Ans, la Peste noire, les conflits de religion la monarchie française s’impose dans les institutions et dans les cœurs. Les populations éprouvent le besoin d’une autorité indiscutée et héréditaire. On exalte le Roi dans les « miroirs de princes » et l’on dégage, peu à peu, des tempéraments, des lois du Royaume pour contenir son autorité dans ce que le XVIe siècle nommera les lois fondamentales du Royaume.
Jean Bodin : distinction entre État et gouvernement
État, gouvernement et souveraineté
Au XVIe siècle surgit un grand auteur qui va à la fois définir l’État et la souveraineté.
L’État, pose Jean Bodin au tout début des Six livres de la République « est un droit gouvernement de plusieurs mesnages, et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine ».
– « Droit gouvernement » signifie qu’il n’y a d’authentique État que de droit, que légitime, en quelque sorte, et respectueux de la justice, n’en déplaise à Machiavel.
– « Puissance souveraine » : la souveraineté est une idée moderne11, une idée que ne pratiquait guère le Moyen âge, et qui ne laisse pas d’être dangereuse, au demeurant. Bodin y tient parce qu’il s’agit de pacifier les esprits au sortir des guerres de religion, et qu’à la limite mieux vaut, pense-t-il, une décision arbitraire indiscutée d’un prince que de s’entre-tuer pour des querelles insolubles.
Il n’y aura de souveraineté que par droit gouvernement ; Bodin élimine toutefois la notion de constitution mixte, relancée à la même époque par ces adversaires de l’autorité que sont les monarchomaques, ce courant de pensée né lors des conflits religieux, d’abord chez les calvinistes, récupérés chez les catholiques. Les monarchomaques, nourris de la première école historique du siècle, vont bâtir un roman à leur convenance, rattacher la monarchie à de vieilles assemblées, à des critères aristocratiques, contractualistes, limitant les prérogatives du Prince pour, finalement, lui interdire de dicter la foi commune.
Trois supports possibles à la souveraineté : monarchie, aristocratie, gouvernement populaire
Bodin est à l’opposé de cette conception. Il critique la constitution mixte au nom de la constitution pure, de sa rigoureuse logique interne, et ne trouve que trois supports à la souveraineté : la monarchie, l’aristocratie, le gouvernement populaire.
Le régime selon son cœur est la monarchie ; mais il introduit une sous-distinction nouvelle en ce sens que, d’après lui, les trois États fondamentaux de la république sont susceptibles de connaître des formes différentes de gouvernement : le monarque, par exemple, peut se réserver toute la souveraineté, ou la partager avec une noblesse, ou même faire accéder le peuple aux places et honneurs. Il ne faut donc pas confondre, comme les Anciens l’ont fait à tort, estime Bodin, États et gouvernements. La vraie monarchie est la monarchie légitime et royale, cependant susceptible des trois modes de gouvernement.
La monarchie héréditaire offre une garantie maximale contre la tyrannie
La monarchie à gouvernement royal n’en sera pas moins tempérée, soucieuse de mettre chacun à sa place en vertu de la « justice harmonique », « entremêllant doucement les nobles et les roturiers, les riches et les pauvres12 ». Bodin écarte par conséquent des « droits gouvernements », des formes légitimes de l’État les monarchies seigneuriales ou tyranniques qui font peu cas des droits des sujets : la souveraineté est incapable de mixité ; en revanche, le gouvernement royal peut fort bien combiner une administration populaire et une administration aristocratique.
Le monarque, pense aussi Bodin, est moins démagogue qu’une assemblée, mieux armé pour résister aux flatteries de l’opinion ; en lui seul la souveraineté s’incarne vraiment, puisqu’il est unique et qu’elle est indivisible.
La monarchie n’est pas exempte de dangers ; elle peut même verser dans la tyrannie ; mais les autres régimes également ; et la plupart des dangers sont conjurés quand la monarchie devient héréditaire : Aristote a eu grand tort de mépriser cette forme, bien supérieure aux monarchies électives : l’exemple capétien l’atteste. L’hérédité évite la discontinuité, assure la permanence d’une politique, épargne les querelles de succession.
Le thème de la constitution mixte et ses diverses interprétations
Bodin, en raison de son approche de la souveraineté, avait donc donné congé au vieux thème de la constitution mixte. L’idée avait un passé : elle aurait un avenir.
Aristote et saint Thomas : la monarchie modérée
C’est surtout, on l’a vu, Aristote qui l’avait vantée. Au XIIIe siècle, saint Thomas d’Aquin l’a retrouvée en l’infléchissant pour son époque : le mixte cessait d’être l’édulcoration de deux régimes vicieux, l’oligarchie et de la démocratie ; il contrebalançait plutôt la royauté par une dose de démocratie et une autre d’aristocratie. Saint Thomas se montrait, au fond, à la différence d’Aristote, très largement favorable à la royauté ; régime dominant de son siècle ; il y voyait toutes sortes d’avantages : l’unité, la paix, la conformité à la nature (il y a un seul Dieu, une seule reine dans la ruche, un seul cœur dans le corps, etc.) L’expérience atteste les mérites de la monarchie. La tyrannie est plus à redouter du gouvernement populaire que de celui d’un seul.
Fortescue et Dumoulin : la monarchie limitée
Aux XVe et XVIe siècles, la monarchie mixte trouve de nouveaux chantres ; un Anglais, Lord Fortescue, élabore le concept de « monarchie limitée ». En France, Dumoulin parle joliment d’une monarchie avec « assaisonnement, composition et température » d’aristocratie et de démocratie : élégante formule ! le régime mixte est donc essentiellement une monarchie contenue dans un certain nombre de limites13.
Les monarchomaques : la monarchie sous contrôle
Il n’en reste pas moins que la constitution mixte a aussi été utilisée à des fins polémiques pour contester le pouvoir monarchique. Tel était le cas pour les monarchomaques, évoquée plus haut, qui dénonçaient dans la monarchie absolue une tyrannie. Bien que les protestants (et surtout Luther) aient été d’ordinaire très respectueux de l’autorité établie (omnis potestas a Deo…), Calvin a introduit la notion de « héros manifeste », susceptible, à certains moments de l’Histoire, de traduire la volonté divine en châtiant le mauvais chef. Théodore de Bèze, son continuateur à Genève, allait même reconnaître un rôle permanent et institutionnel aux « magistrats intermédiaires », à ces corps constitués du Royaume qui recevaient le droit d’intervenir au nom du peuple en cas de violation des engagements contractuels du monarque.
Montesquieu
Le thème de la constitution mixte est surtout repris au XVIIIe siècle par Montesquieu : la chose y est, sinon l’expression. L’auteur de L’esprit des lois s’intéresse fondamentalement aux monarchies, seul régime approprié aux grands États modernes : deux avatars lui en paraissent acceptables pour la liberté, la monarchie à l’anglaise, mais aussi la monarchie… à la française qu’il ne faut pas non plus négliger.
– La monarchie à l’anglaise est celle dont les commentateurs ultérieurs ont tiré la fameuse « séparation des pouvoirs ». La monarchie se limiterait par une sorte de mécanique constitutionnelle, alors que, naguère, dans la tradition classique, le tempérament naissait d’une communauté de foi entre gouvernants et gouvernés. Pour Montesquieu, la recette est bien connue, le pouvoir arrête le pouvoir, il le « balance ».
– Dans la monarchie à la française, les limitations proviennent des corps intermédiaires, notamment la noblesse et les Parlements.
Arrêtons là cet inventaire, que l’on pourrait encore barioler de touches multiples, pour essayer de dresser une taxinomie des monarchies.
Modes de légitimation de la monarchie
Différents modes ont historiquement permis de légitimer ce régime : le droit divin, la providence et l’histoire, la patriarcalité, le contrat, la raison…
Légitimation par le droit divin
Le droit divin se nourrit naturellement de l’Écriture :
Tout pouvoir vient de Dieu… C’est par moi que règnent les rois… Tu n’aurais pas de pouvoir s’il ne te venait d’en-haut…
L’accent est placé sur le caractère religieux de la monarchie chrétienne. Mais comment le Roi tient-il de Dieu ? directement, in concreto, ou bien indirectement, in abstracto ?
L’interprétation dominante, dans la tradition catholique, est une légitimation médiate : tout pouvoir, certes, vient de Dieu ; cependant, il en procède per populum, sans investiture divine directe. Qu’on n’aille point imaginer quelque nécessaire passage par le suffrage universel : simplement, le droit divin est une manière de frein mystique au pouvoir du monarque, qui règne par la seule grâce de Dieu, non pour ses mérites singuliers mais par la faveur du ciel. « Mandat céleste », disait les orientaux. Principe de légitimité extrêmement fort, et néanmoins rassurant.
Plus tard, aux XVIIe– XVIIIe siècles, le droit divin va être utilisé non plus comme frein mystique mais comme transcendant moteur du pouvoir. Le Roi est supposé tenir directement de Dieu, investi par une huile « venue du ciel » (privilège que même le Saint-Père ne possède pas, rappelle avec hauteur Louis XIV) ; le Roi ne dépend de personne ici-bas, il voit son autorité exaltée.
Légitimation par la providence et l’histoire
La seconde manière de légitimer la monarchie se fonde sur la providence et l’histoire. Vision quelque peu augustiniste : tout ce qui existe est bon et doit être respecté ; Dieu fait les rois littéralement, « au pied de la lettre », dira Joseph de Maistre. Le même pose, non sans profondeur, dans ses Considérations sur la France, que « le roi défend d’obéir à l’homme ».
Mais ce providentialisme « littéral » n’est pas sans présenter quelque danger pour la cause qu’il sous-entend, car si Dieu fait des rois, comme naguère il faisait l’Empire romain, il les défait aussi. En admettant que la Providence seule légitime les rois, elle conserve aussi bien les révolutions : là est sans doute la grande aporie de Joseph de Maistre, lointain héritier, au XIXe siècle, de cet augustinisme politique. La Révolution est satanique, fléau de Dieu pour le châtiment des hommes, soit ; cela est une explication consolante pour autant que la Restauration se fasse et dure ; mais quand c’est la Révolution qui l’emporte, quand l’Histoire paraît changer de cap, n’est-il pas plus délicat de ramener la légitimité monarchique à la volonté providentielle, et, surtout, de continuer à défendre la légitimité monarchique ?
Légitimation par la prescription acquisitive
Aussi certains auteurs, moins mystiques que Maistre, ont-ils cherché à fonder la monarchie sur la prescription acquisitive. Tel est particulièrement le cas d’Edmund Burke, le traditionaliste anglo-irlandais de la fin du XVIIIe siècle, spectateur critique de la Révolution française.
La prescription acquisitive, déjà entrevue chez Hume (et peut-être même chez Grotius et les jusnaturalistes modernes ?) consiste à dire qu’il se peut bien qu’à l’origine le peuple soit dépositaire du pouvoir, mais qu’à partir du moment où il l’a concédé à un prince, qu’une dynastie s’installe et qu’elle fait ses preuves dans la durée, l’histoire, le temps, l’expérience la légitiment.
Burke ne peut pas hypostasier l’instant présent : ce n’est pas ce que les hommes pensent aujourd’hui qui compte, mais ce que les siècles ont consacré. De cette façon, l’on doit légitimer les rois, mais aussi tous les privilèges, toutes les limitations coutumières qui les accompagnent et les limitent.
Légitimation par la justification patriarcale
La justification patriarcale est celle aperçue chez Filmer et Bonald, que l’on retrouverait éloquemment exposée chez Bossuet : le monarque est un père, il gouverne des familles, et il est respectable comme analogue du père.
Légitimation par le contrat social
Le contrat social, le contrat de gouvernement, qui ne se recoupent d’ailleurs pas exactement, il s’en faut, ont une histoire longue et complexe14. On s’est habitué à y voir une machine de guerre contre la monarchie : c’est vrai d’un Rousseau ; encore cet argument est-il extrêmement ambigu, ductile, réversible, utilisé historiquement à des fins contraires. Chez Hobbes, le contractualisme fonde l’absolutisme ; chez Locke, le libéralisme. Deux avatars, finalement, d’une même « monarchie populaire » !
Légitimation par la raison et l’utilitarisme
On peut enfin justifier la monarchie par la raison et l’utilitarisme. La monarchie n’est pas un régime plus absurde qu’un autre.
Benjamin Constant, cet autre libéral sorti fatigué des épreuves de la Révolution française, était devenu un royaliste de raison, exaltant le rôle du « pouvoir neutre » que devait tenir le prince héréditaire. Maurras, avec sa forte logique, pensait pouvoir « démontrer la monarchie comme un théorème ».
On peut douter que cet argument soit le meilleur ; Maurras lui-même l’assortissait d’un détour par l’« empirisme organisateur », où sa raison se faisait concrète, à l’écoute des faits historiques : esprit de finesse et esprit de géométrie…
Classification des monarchies
Au bout du compte, à partir de ces différentes réflexions doctrinales, comment classer les monarchies ?
La monarchie est cette forme de gouvernement où s’exprime, au sommet de l’État, la volonté physique d’un seul ; volonté juridiquement la plus haute, contrainte en principe par nul autre organe, et dévolue héréditairement. En pratique, il est possible d’étager dans un sens progressivement descendant un tel régime.
La tyrannie
On peut partir de la tyrannie ou du despotisme, gouvernement d’un seul, forme monarchique sans fondement de droit, qu’il faudrait différencier de la monarchie proprement dite, comme toute la tradition politique l’a fait, sauf Hobbes.
La monarchie absolue
Vient ensuite la monarchie absolue, qui n’est point despotique, que limitent coutumièrement les lois fondamentales. Que cette constitution soit coutumière, non écrite, n’enlève rien de sa réalité. La monarchie absolue est encore compatible avec le respect des lois divines, naturelles, de « maximes générales » ; elle admet le « gouvernement à conseil » et les procédures qui peuvent ralentir l’autorité du prince, sauf à ne jamais lui faire obstacle définitivement. Si le Roi voulait avec persévérance, il s’imposait : en cela résidant sa souveraineté absolue.
La monarchie tempérée ou limitée
En troisième lieu apparaît la monarchie tempérée, limitée, disait Fortescue : elle a les mêmes caractéristiques que la monarchie absolue, tout en étant soumise à certaines limitations dans l’exercice de son autorité. Le monarque n’y peut franchir, notamment en matière législative, divers obstacles constitutionnels.
La monarchie parlementaire
En quatrième lieu, la monarchie parlementaire est un dualisme, un compromis entre les principes rivaux de souveraineté nationale et de souveraineté monarchique. L’exécutif y reste monarchique, mais le gouvernement, lui, est plus ou moins démocratique.
Forme à laquelle Rousseau aboutissait dans son Contrat social15. Il ne réputait légitime que les régimes démocratiques ; en revanche, dans ce cadre, des exécutifs pouvaient prendre les trois formes aristotéliciennes habituelles ; les préférences de Rousseau allaient à l’aristocratie ; il répudiait la démocratie mais admettait la monarchie. Les « monarchies » contemporaines sont, en vérité, des royautés démocratiques rousseauistes.
Régimes à forme monarchique
En allant encore un peu plus avant dans la dégradation des principes monarchiques, l’on rencontre des régimes à forme monarchique où le Roi n’est qu’un symbole, disposant de pouvoirs tout à fait formels, buttes témoins de temps anciens.
Classification : régimes à principe monarchique / régimes à exécutif monarchique
Dès lors, la véritable césure n’est pas à placer, ainsi qu’on le répète trop facilement, entre monarchie absolue et monarchie constitutionnelle, mais, comme le suggère à bon escient M. Stéphane Rials, entre monarchie limitée et régime à exécutif monarchique16.
Les deux premières catégories (monarchie absolue, monarchie limitée) respectent le principe monarchique proprement dit : le Roi est toujours, en droit, quelquefois en droit et en fait, le titulaire de la souveraineté. À l’inverse, dans le système à exécutif monarchique, le principe monarchique a disparu. Il lui arrive de se maintenir, quelques fois, dans les transitions qui ménagent l’exécutif ; le plus souvent, il a totalement disparu.
Soulignons encore que toute monarchie qui n’est pas despotique est constitutionnelle ; donc, nommément, la monarchie absolue.
Quant à la monarchie limitée, incarnée par la Charte de Louis XVIII en France, sous les deux premières Restaurations, elle était compatible avec l’agencement de certaines procédures limitatives de l’autorité royale ; elle ne déterminait pourtant pas de façon obvie le sens de son évolution. Il est vrai qu’en fait, chez nous, le système a capoté en 1830. Mais 1830 ne fut pas un « coup d’État » de Charles X comme les libéraux l’ont soutenu ; ce fut, simplement, de la part du dernier roi de France, le refus d’une évolution de la monarchie limitée vers ce qui a été mais aurait pu ne pas être.
Les monarchies allemandes du XIXe siècle, celle de Prusse en particulier, sous l’instigation de Bismarck, ont évolué autrement : 1862 fut, en Prusse, un 1830 qui aurait tourné autrement, et Bismarck un Polignac plus habile et plus chanceux. L’évolution de la Charte de 1814 n’était pas fatalement le parlementarisme…
Cette rétrospective théorique étant suffisante pour prendre la mesure de la réflexion politique générale sur la monarchie, venons-en au modèle historique institutionnel de la France d’Ancien Régime.
Modèle historique de l’ancienne France
Observation préalable : le modèle historique français couvre treize siècles. Impossible, sans caricaturer, de le résumer de manière unitaire. Des visions changeantes de la monarchie ont régi la France :
La royauté mérovingienne patriarcale et militaire
Avec les Mérovingiens prévalut une royauté patriarcale, militaire, de style germanique barbare, où l’hérédité joua un grand rôle, au sens du droit privé. Le roi était une sorte de grand propriétaire et la dévolution de la couronne s’effectuait comme celle de biens propres entre particuliers.
La royauté carolingienne : le sacre fait le Roi très chrétien
À partir du milieu du VIIIe siècle, la monarchie carolingienne inaugura le sacre pour légitimer le changement de dynastie. Le Roi devint « Roi très chrétien » et « par la grâce de Dieu », pouvoir d’un troisième type, qui n’était ni tout à fait barbare, ni tout à fait romain.
La royauté capétienne : origine du sacre anticipé
On s’étendra plus longuement sur la monarchie capétienne, forme qui a durablement triomphé, dont il reste un héritage et des leçons peut-être.
En 987, Hugues Capet a été élu contre le dernier des représentants de la race carolingienne, et élu au motif que la monarchie « n’était pas héréditaire ». Or, à partir de lui, l’hérédité va être récupérée en coutume, mais grâce à un subterfuge : le sacre anticipé. Hugues et ses successeurs ont pu conserver la couronne dans leur lignée parce qu’on admettait que le sacre faisait le roi, à cette époque, et qu’ils procédaient au sacre anticipé des aînés.
Ainsi la coutume constitutionnelle s’est-elle progressivement introduite. On procédait au sacre du fils aîné, parce qu’il était le premier en état de succéder, de porter les armes, de prolonger son père ; cela mettait au-dessus de toute discussion la personne royale. La monarchie ne recherchait pas le meilleur, elle soustrayait le successeur à la compétition, « à la brigue et à la cabale » selon l’expression de Bossuet, beaucoup plus tard.
La loi de primogéniture mâle (loi salique)
À partir des années 1316-1328 s’impose le principe de masculinité : non que le Moyen Âge chrétien méprisât la femme ; la femme pouvait être régente (Blanche de Castille le fut puissamment), commander des armées (Jeanne d’Arc…), et les catholiques rendaient un culte à Notre-Dame.
Pourquoi a-t-on donc écarté les femmes du trône de France en 1316 ? Pour des raisons un peu contingentes, sans doute, à cette date. Le frère du roi défunt, le futur Philippe V, alors Comte de Poitiers, était un personnage jeune, dynamique, ambitieux, plein d’initiatives, qui a quelque peu placé ses compétiteurs potentiels devant le fait accompli. L’on ne trouva pas beaucoup de justifications sérieuses sur le moment, en dehors de quelques arguties sur la proximité en degrés de saint Louis. Cela ne valait rien. Mais ce qui s’est passé en 1316 explicitait, confirmait une immémoriale pratique.
Depuis Clovis, jamais une femme n’était montée sur le trône de France, lors même qu’elle avait l’aînesse. Louis VII, au XIIe siècle, était horrifié de n’avoir que des filles d’Aliénor d’Aquitaine. Pourquoi ressentait-il ce besoin de masculinité ? Quelle était la raison profonde de la coutume ? Très vraisemblablement un motif religieux, théologique : le roi de Francs, oint par le sacre, est un « Christ », un nouveau Melchisédech, un roi-prêtre, et les femmes n’ont pas plus accès à ce trône qu’à l’autel.
En 1328, on a écarté les descendants mâles par les femmes non parce qu’Édouard III d’Angleterre était un Anglais (ainsi qu’on l’a dit tardivement) mais parce que sa mère était détestée et qu’on lui refusait de « faire pont et planche ». Édouard Plantagenêt était tout aussi français que Philippe de Valois : cet Angevin, fils d’Isabelle de France, petit-fils de Philippe le Bel, francophone autant qu’il est possible, n’était pas « un étranger », argument anachronique. C’est beaucoup plus tard, vers la fin de la guerre de Cent ans, qu’émergea la notion de nationalité, et que Jeanne voulut « bouter l’Anglois hors de France ». En 1328, si le roi d’Angleterre était devenu roi de France, il y a fort à parier que l’Angleterre, quand ce ne serait que par le poids démographique des deux royaumes, se serait francisée…
La loi de continuité de la couronne
Au début de XVe siècle s’élabore l’instantanéité de la succession : « le mort saisit le vif », énoncera le brocard. Thème lié aux problèmes du sacre et de l’interrègne.
Depuis ses origines, le sacre, en France, avait été constitutif de royauté ; mais, à partir de Philippe Auguste, l’on jugea superflu de procéder au sacre anticipé (dont on s’était déjà une fois dispensé pour Louis VI le Gros). Philippe Auguste avait épousé Isabelle de Hainaut, descendante des Carolingiens ; les Carolingiens eux-mêmes étaient alliés aux Mérovingiens (au moins depuis Berthe aux Grands pieds, épouse de Pépin le Bref) ; la postérité de Philippe Auguste réunissait les trois dynasties, et n’était plus contestée17.
Une difficulté juridique courait : puisqu’on ne sacrait plus par anticipation (cela devenait superflu), mais que le sacre continuait à faire le roi, il y avait hiatus, discontinuité, interrègne entre la mort du roi-père et le sacre différé de son successeur, en particulier s’il était mineur. Charles VI tranche par deux ordonnances de 1403 et 1407, décidant que le Roi serait tel dès la mort de son prédécesseur, instantanément, et quel que fût son âge. Cela revenait à rendre juridiquement superflu le sacre : il n’était plus constitutif de royauté, mais simplement déclaratif, aux yeux des légistes.
Seule la force de la coutume faisait le Roi.
La loi d’indisponibilité de la couronne
L’évolution se poursuit dans les années 1419-1420 à l’occasion d’un nouveau drame qui trouve son point culminant dans « le honteux traité de Troyes » de 1420. Charles VI, atteint de folie, dépassé par les événements, a exhérédé le Dauphin, futur Charles VII au profit de l’enfant à naître de sa fille Catherine et d’Henri V d’Angleterre18.
Il y avait là un curieux retour des choses : les Anglais avaient commencé la guerre de Cent ans au nom de leur prétendue légitimité contre les Valois ; et voilà qu’ils essayaient de récupérer la couronne de France en épousant, si l’on ose dire, la légitimité des Valois ! De fait, il y avait eu, entre temps, une révolution anglaise, une substitution de branche, et le roi d’Angleterre n’était plus, lui-même, l’aîné des Plantagenêts, ce qui le plaçait en porte-à-faux pour conserver intacte sa revendication !
Quoiqu’il en soit, au traité de Troyes, Charles VI a voulu changer l’ordre coutumier de succession et un juriste, anticipant d’ailleurs quelque peu sur l’événement, mit en forme le principe de l’indisponibilité de la Couronne, qui allait être, dorénavant, la clef juridique de la monarchie française.
Le Roi n’est pas le maître de sa couronne, il n’est pas un héritier véritable, mais un successeur ; ou, si l’on préfère, il n’est qu’un « héritier nécessaire ».
La monarchie française n’est que quasi-héréditaire ; elle est « successive et statutaire ».
Le roi régnant ne peut changer quoi que ce soit à l’ordre de succession.
Il ne peut ni abdiquer personnellement, ni faire renoncer un prince du sang.
Ainsi, le Parlement de Paris refusera-t-il d’entériner l’abdication de François 1er en 1525, après sa défaite de Pavie, au motif qu’il était « confisqué au profit de la chose publique ». Jamais un roi de France n’abdiqua jusqu’en 1830, où Charles X, dans des conditions révolutionnaires, eut la faiblesse de le faire pour tenter de sauver les meubles, sauf à reprendre assez vite son geste en exil.
De même, en 1713, sera tenue pour nulle et non avenue la renonciation arrachée à Philippe V d’Espagne, l’ancien Duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui encore, le légitime successeur des rois de France n’est pas le Comte de Paris, issu de la branche cadette d’Orléans mais le Duc d’Anjou, descendant direct par ordre de primogéniture de Philippe V et de Louis XIV.
De même encore, en 1714, le Roi Soleil ne parvint pas à légitimer durablement ses bâtards. Son successeur Louis XV, dans l’édit de 1717 annulant l’acte, rappela que le Roi était « dans l’heureuse impuissance » de violer les lois fondamentales du Royaume.
La loi de catholicité
Dernière loi fondamentale à s’être affirmée, fin XVIe siècle : celle de catholicité. Last but not least.
Comme pour la masculinité, il s’agit d’une explicitation tardive pour un principe qui traversait les siècles. Depuis Clovis et sa conversion, une loi de religion chrétienne s’imposait au roi de France. La Réforme compliqua les choses, et c’est pourquoi il fallu rappeler le principe : Henri de Bourbon-Navarre, cousin d’Henri III au vingt-et-unième degré (leur ancêtre commun était le sire de Clermont, sixième fils de saint Louis), avait la primogéniture et la masculinité pour lui ; mais non la catholicité en 1589. Il ne devint pleinement le Roi qu’en se convertissant quatre ans plus tard. Cette conversion consacra la règle de catholicité.
À cette occasion fut magnifiée la « loi salique », par un arrêt du Parlement du 28 juin 1593.
Il y était dit qu’on ne pouvait pas, sous prétexte de religion, choisir un roi étranger : la Sainte-Ligue catholique avait fortement songé à la candidature de la princesse Isabelle-Claire-Eugénie, descendante d’Henri II de Valois mais fille de Philippe II d’Espagne. Les ligueurs faisaient sans hésitation primer la catholicité sur la masculinité et la primogéniture.
D’aucuns ont même cru trouver, plus tard, dans cet arrêt Lemaistre, le fondement d’une règle de nationalité. Double erreur sans doute.
– L’arrêt Lemaistre rappelait une loi de sanguinité capétienne, il ne posait pas une loi nouvelle de nationalité : à preuve, il servait la cause d’Henri de Bourbon, roi de Navarre, dont on aurait fait, au sens moderne, un « prince étranger » !
– L’arrêt Lemaistre, par ailleurs, rappelait implicitement que la légitimité monarchique française n’était pas seulement la primogéniture masculine, ni même la catholicité, mais tout cela ensemble.
Significations du sacre
Et le sacre, demandera-t-on, où le situer dans ce complexe ?
Le sacre a eu, dans l’histoire monarchique française, une triple signification ; deux sont allées diminuant ; la troisième s’est maintenue au moins jusqu’à la Révolution.
Le sacre comme sacrement
Sur le plan théologique, le sacre s’est longtemps assimilé à un sacrement. Il le resta à peu près jusqu’à la réforme grégorienne. Au début du XIIIe siècle, sous l’effet de cette réforme, l’Église catholique limita à sept le nombre des sacrements, y conservant le sacre des évêques, en excluant le sacre des princes.
Auparavant, le nombre des sacrements n’était pas limité ; le sacre des rois était très proche de celui des évêques ; il se faisait sur la tête, à la différence du sacre des reines (conservé en France jusqu’à Marie de Médicis, mais tenu pour subsidiaire, pour inférieur). Le Roi, lui, était « évêque du dehors » et n’apparaissait plus comme un « pur lai ».
Or, chose à première vue curieuse mais qui s’explique, c’est l’Église elle-même qui a tenu à désacraliser les rois, et à faire que les sacres royaux ne soient plus des sacrements. L’Église, qui avait, un moment, « épiscopalisé » la fonction royale, changea d’attitude lors de la querelle du sacerdoce et de l’Empire. Elle visait du reste moins le roi de France que l’Empereur du Saint-Empire. Les empereurs germaniques avaient fini par combattre les papes réformateurs au nom de leur césaro-papisme : ils avaient besoin de conserver la nomination d’évêques-fonctionnaires pour tenir en main leur Empire : leurs choix étaient administratifs et politiques, pas nécessairement spirituels, ce qui engendrait nicolaïsme et simonie. La Papauté, émancipée de la mainmise des empereurs dès la seconde moitié du XIe siècle, n’eut de cesse de récupérer la nomination des évêques. L’Empereur refusait de se reconnaître simoniaque puisque son sacre en faisait un clerc. Pour réfuter cette position, force fut aux papes de diminuer la signification théologique du sacre, et les rois de France en furent indirectement victimes.
Le caractère juridique du sacre
On a dit comment le sacre s’était pareillement dépouillé de sa portée juridique, devenant, au début du XVe siècle, simplement déclaratif de royauté, cérémonie purement festive et spectaculaire, sans portée juridique puissante.
Il n’en conserva pas moins un immense prestige sur le plan politico-mystique.
Le sacre exprimait à cet égard la primauté du spirituel, l’idée-force que le pouvoir ne venait pas d’en-bas mais d’en haut. Le gouvernement des hommes ne procède pas des qualités humaines mais des grâces de Dieu. L’opinion publique du XVe siècle ne suivit d’ailleurs pas les légistes : Jeanne d’Arc le montre bien, qui continua d’appeler Charles VII « gentil Dauphin » jusqu’à ce qu’elle l’eût mené se faire oindre à Reims.
Le caractère rassembleur du sacre
Le sacre a gardé, semble-t-il, à peu près jusqu’à la fin du XVIIIe siècle son impact intact : les rois en tiraient un pouvoir thaumaturgique très apprécié, qui mobilisait des milliers de scrofuleux. Après Louis XVI, oint à Reims en 1774 (malgré les réserves de Turgot), il y eut encore deux sacres en France : Napoléon 1er à Notre-Dame (l’on sait qu’il snoba le Pape et se couronna lui-même) et Charles X, à Reims, en 1825. Charles X, ne voulant, pas plus que son frère, être « le roi de deux peuples » avait imaginé un cérémonial renouvelé quelque peu, entraînant les maréchaux de l’ancienne France autant que ceux de l’Empire : son intention fut mal ressentie, Béranger dauba méchamment sur « le sacre de Charles le Simple », et il n’y eut que 125 scrofuleux à se déplacer : la Révolution avait brisé le charme…
L’héritage spirituel de la monarchie française
Quel bilan peut-on esquisser de l’héritage spirituel de la monarchie française ?
Des régimes monarchiques existent de nos jours
Encore une fois, la monarchie, expressis verbis, n’est pas tout à fait un régime obsolète, ni inconnu de l’Europe contemporaine.
Les Français la rencontrent à leurs portes, en Espagne, au Luxembourg, en Belgique, en Angleterre…
En Espagne et au Grand-Duché, ce sont même des princes de leur race, des Capétiens, des Bourbons, qui règnent, et, en Suède, la dynastie est française, sans parler du prince consort de Danemark ou des Grimaldi.
Mais ces monarchies (mise à part celle, municipale et lilliputienne, de la Principauté) ne sont que des démocrates à forme monarchique. Il n’y subsiste de monarchique qu’un très pâle reflet, qu’une ombre portée de l’Histoire.
Est-ce le sort inévitable assigné par la modernité aux monarques ? Rien l’autorise à penser que l’histoire se soit définitivement bloquée sur une seule formule politique qui serait la démocratie et la construction rousseauiste. Il y aurait quelque présomption, quelque simplisme même, à le croire.
Si la monarchie a un sens, et peut-être un avenir, si elle ne doit par être exclusivement l’objet de l’attention des antiquaires, mais peut encore entraîner l’intérêt des politologues ou la médiation des philosophes, c’est à la condition d’être, comme son nom y invite, autre chose que la démocratie, une réserve, une potentialité, une relève du droit et des libertés.
La monarchie : transcendance, modération, incarnation du pays
L’intuition de la monarchie traditionnelle est qu’il importe de lester le pouvoir politique d’une charge de spiritualité. Malgré qu’elle en ait, la démocratie moderne s’agenouille devant la force et devant l’homme : elle vénère le nombre, elle ne transcende pas l’humain, elle ne sait en appeler de l’homme qu’à l’homme.
La monarchie est la possibilité d’une démarche différente. Elle a pu verser dans ces erreurs que furent le cléricalisme, la théocratie, le gallicanisme… Le Royaume n’est pas de ce monde, mais les royaumes du monde sont de Dieu.
Le Roi est, par essence, un modérateur, un « apaiseur » aimait à dire saint Louis.
Le Roi incarne la nation : cela n’est pas peu, et Maurras, par exemple, a postulé le « nationalisme intégral » non point, comme on lui a fait dire quelquefois, par excès de nationalisme, mais, au contraire, parce qu’à ses yeux le nationalisme s’achèverait naturellement dans la monarchie.
C’est qu’en effet, si le Roi incarne la Nation, il en est, d’un même mouvement, le modérateur. Il est un principe qui va au-delà de la Nation.
Il n’exalte pas, il n’idolâtre pas le demos ou l’ethnos à l’instar des jacobins et du nationalisme débridé des révolutionnaires19 ; la monarchie tempère et finalise la Nation. La remarque ne vaut pas seulement pour la France : combien de pays étrangers ont sombré dans l’hybris en perdant leur monarchie : de la Libye à l’Iran, les exemples se bousculent… Claude de Seyssel, au XVIe siècle, parlait du « retenail » de la monarchie : cette image semble pertinente. Démocratiser la monarchie serait lui faire perdre sa vocation profonde.
Nul régime n’est parfaitement abject ; nul n’est parfaitement satisfaisant. La légitimité politique chemine humblement entre des dangers. La monarchie chrétienne traditionnelle semble avoir, malgré tout, incarné, à certains moments, un optimum historique dont on ne peut qu’avoir intérêt à garder mémoire. Gustave Thibon a écrit quelque part cette réflexion marquée au coin de sa sagesse paysanne, qui vaudrait pour une méditation sur la monarchie d’aujourd’hui :
Il faut apporter à ce monde non pas ce dont il s’enivre, mais ce dont il a besoin, et donc travailler à contre-courant.
- Cf. Bertrand Renouvin, « Monarchie et démocratie ». Cahiers de Royaliste n° 14, 1984. Le mouvement de la Nouvelle Action Royaliste défend, depuis près de vingt ans, l’idée de royauté démocratique en France. Il a des émules au Portugal, en Italie, et auprès de divers princes exilés de l’Europe de l’Est, jaloux des lauriers du roi d’Espagne.↩
- C’est l’originalité des idées politiques de l’actuel Comte de Paris (au moins depuis 1946-1947…) ; ses ancêtres furent libéraux, parfois républicains ; ils n’étaient pas encore démocrates.↩
- Historiquement, la définition grecque de la tyrannie n’est pas si simple… Cf. Claude Mosse, La tyrannie dans la Grèce antique, 1969. Le tyran grec fut, à la fois, le défenseur du peuple, des faibles, des opprimés, et l’adversaire de la démocratie que, néanmoins, il prépara souvent (à l’inverse de ce que dit Platon). On trouve aussi chez Platon, au livre IV des Lois, l’évocation du « bon tyran » et l’aisynnète d’Aristote y ressemblerait fort.↩
- De la Démocratie en Amérique, tome I↩
- Roland Mousnier, Monarchies et royautés de la préhistoire à nos jours, Librairie académique Perrin, 1989. Voir aussi, du même auteur, La monarchie absolue en Europe, du Ve siècle à nos jours, PUF, 1982.↩
- Homère, Iliade, II, v. 204-205. Passage cité en épigraphe par Maurras dans l’Enquête sur la monarchie.↩
- Léviathan, début du chapitre XIX.↩
- Rép., VIII, 565 d et suiv.↩
- Lois, III, 693 d.↩
- Politique, III, ch.14. Sur la royauté dans l’ancienne Grèce, que l’auteur distingue soigneusement, du reste, de la « monarchie », on pourra lire à belle synthèse de M. Pierre Carlier, La Royauté en Grèce avant Alexandre, Strasbourg, 1984. Groupe de recherche d’histoire romaine (sic) de l’Université des sciences humaines de Strasbourg, Études et travaux, VI).↩
- Sur ce sujet, avec notamment une contribution sur Bodin et Hobbes, les actes du Colloque de 1989 organisé par l’Association Louis XVI, De la souveraineté, Paris, 1971.↩
- Les Six livres de la République, p. 1052.↩
- Sur Dumoulin l’excellent travail de Jean-Louis Thireau : Charles Du Moulin, 1. Étude sur les sources, les méthodes, les idées politiques et économiques d’un juriste de la Renaissance, Genève, Droz, 1980.↩
- Cf. Simone Goyard-Fabre, L’interminable querelle du contrat social, Ottawa, 1983.↩
- Voir livre III, ch.1, 6, notamment.↩
- Stéphane Rials, Révolution et Contre-Révolution au XIXe siècle, D.U.C.-Albatros, 1987, plusieurs suggestives contributions dans ce riche recueil d’articles.↩
- Cf. Andrew W. Lewis, le sang royal, la famille capétienne et l’État, France, Xe-XIVe siècle, Gallimard, 1986, en particulier p.144.↩
- Autour de ces questions, Françoise Autrand, Charles VI : la folie du Roi, Fayard, 1986, et Jean Barbey, La fonction royale, essence et légitimité d’après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Nouvelles Éditions Latines, 1983.↩
- N’est-il par remarquable que le cri de « Vive la nation ! » ait remplacé, à Valmy, celui de « Vive le Roi ! » ?↩